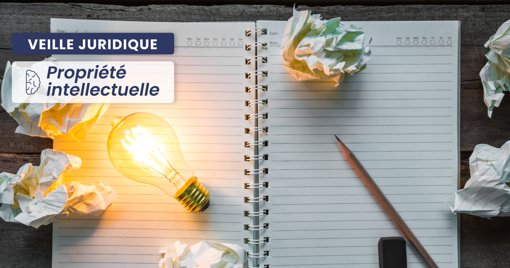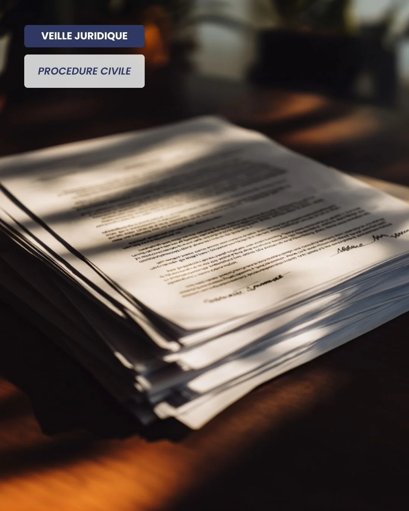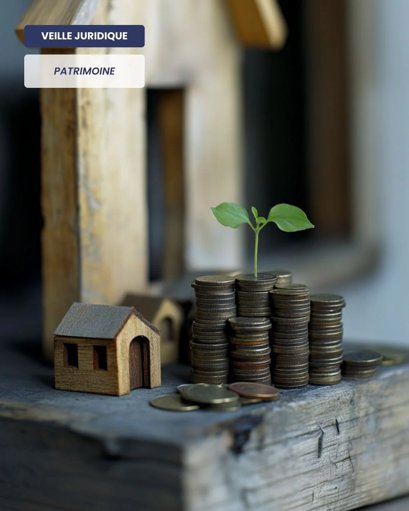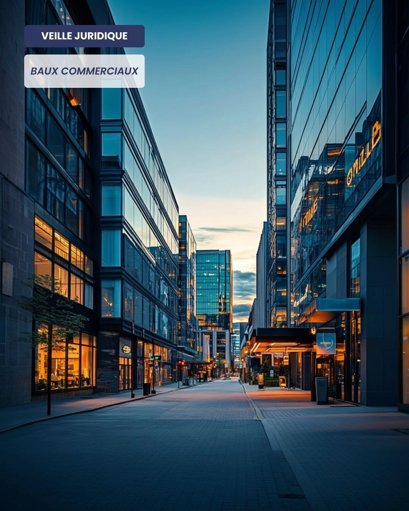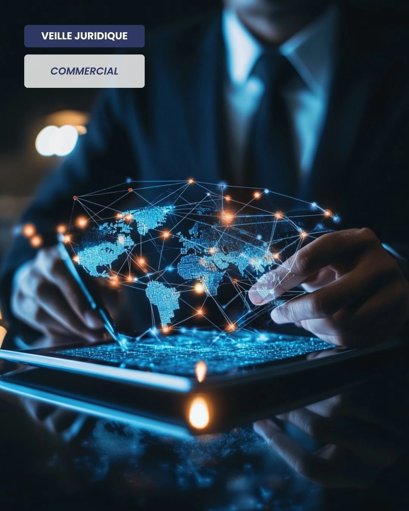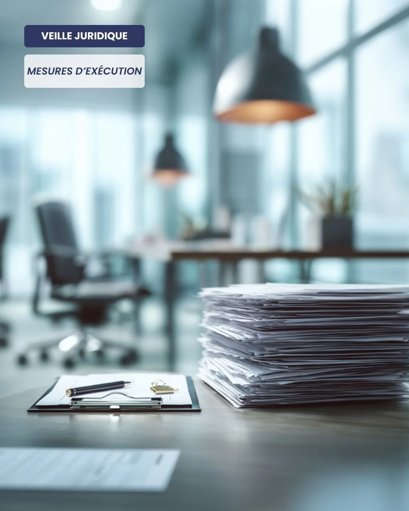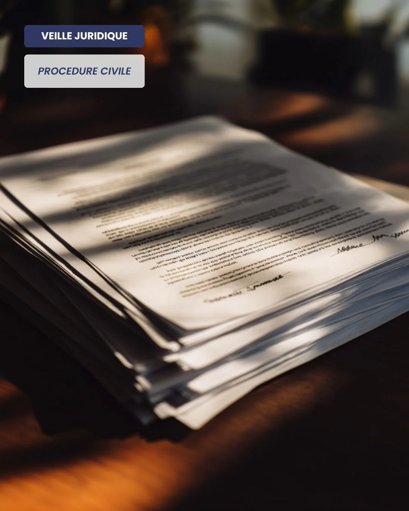La responsabilité pénale du chef d’entreprise
Dans l’exercice de ses prérogatives, le chef d’entreprise supporte une présomption de responsabilité qui a pour conséquence d’attirer, sur sa propre personne, une répression pénale, par suite de la commission d’une infraction. Ce risque, qui pèse sur le chef d’entreprise, ne doit pas être négligé à la fois pour les grandes structures, mais également pour les TPE/PME. Détermination de la qualité de chef d’entreprise Dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier la personne disposant de la qualité de chef d’entreprise. À cet égard, trois critères sont essentiellement retenus par le juge : Un critère formel : il attribue la qualité de chef d’entreprise à celui qui, eu égard à la structure juridique adoptée, doit en assumer la direction. En principe, il s’agit de la personne physique qui dispose des pouvoirs les plus étendus dans l’ordre interne de l’entreprise ; Un critère réel : il désigne la personne qui assume, de manière effective, la direction et l’organisation de l’entreprise. Ce critère est pris en compte lorsque le critère formel ne peut être retenu par le juge ; Un critère temporel : il permet de nommer le responsable de droit ou de fait qui était en fonction lorsque l’infraction a été commise. Caractérisation du fait générateur Pour que la responsabilité pénale du chef d’entreprise soit engagée, un fait générateur doit être établi. Celui-ci peut émaner directement du chef d’entreprise ou de ses salariés. Il résulte de l’article 121-1 du Code pénal que la responsabilité pénale incombe à celui qui a personnellement causé le préjudice. Ainsi, le dirigeant peut être tenu responsable des infractions qu’il a commises, ou de celles survenues dans l’exercice de ses fonctions de direction, notamment en cas de manquement aux obligations de sécurité. Sa responsabilité pénale peut être engagée pour des infractions commises par un salarié, si le défaut de vigilance ou de supervision met en lumière une carence dans l’exercice des devoirs de contrôle qui pèsent sur le chef d’entreprise. En conséquence, le dirigeant ne pourra échapper à sa responsabilité pénale que s’il démontre avoir fait preuve d’une diligence particulière, ou si la faute est exclusivement imputable au comportement de la victime ou du salarié en question. Infractions et sanctions De nombreuses infractions peuvent survenir au sein d’une entreprise. On peut citer, à titre d’exemple, l’abus de confiance, le délit de faux ou usage de faux, le délit de banqueroute, le recel, le blanchiment d’argent ou encore la corruption, parmi bien d’autres. Le non-respect des dispositions législatives ou réglementaires est également susceptible de constituer des infractions pénales. En fonction de la gravité des faits, l’auteur peut être poursuivi au titre d’une contravention, un délit ou un crime. Ainsi, le contrevenant s’expose à : Une condamnation à une amende, pouvant être assortie d’une peine d’emprisonnement, dont le montant et la durée varient selon la gravité de l’infraction ; Des peines complémentaires, telles que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, de diriger, d’administrer directement ou indirectement, une entreprise de manière temporaire ou définitive, pour son propre compte ou pour celui d’autrui. MAJORIS Avocats