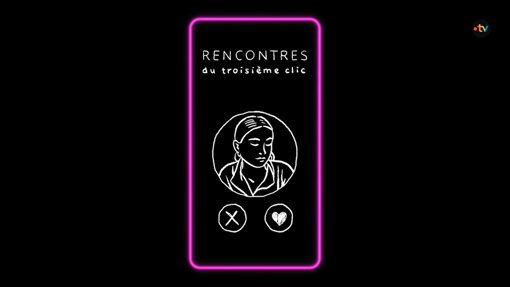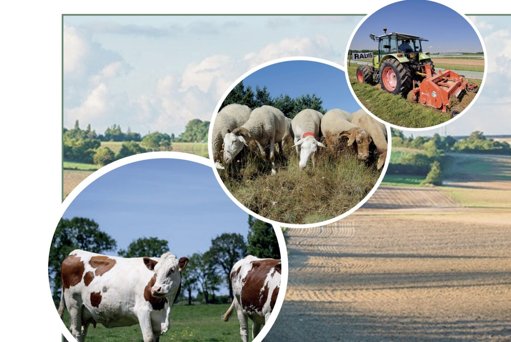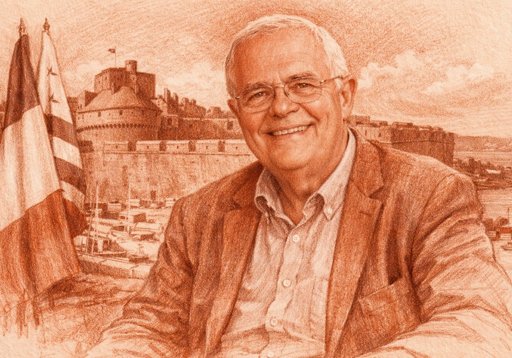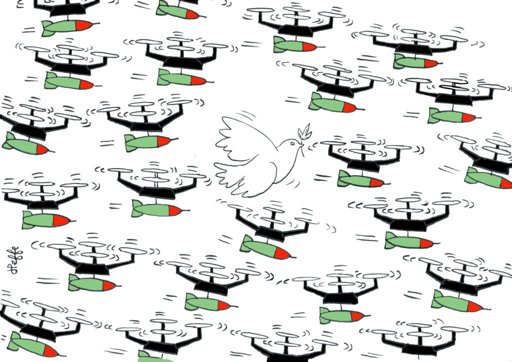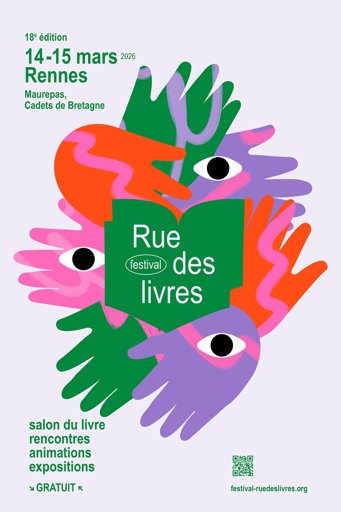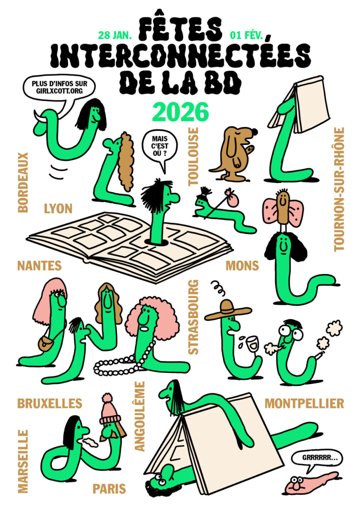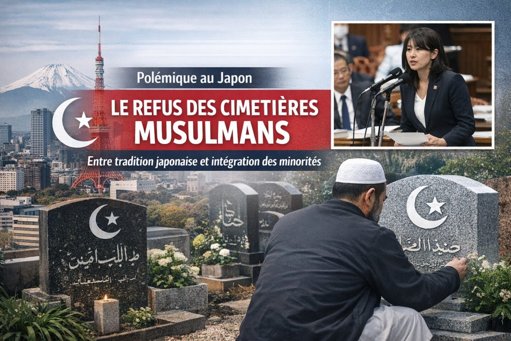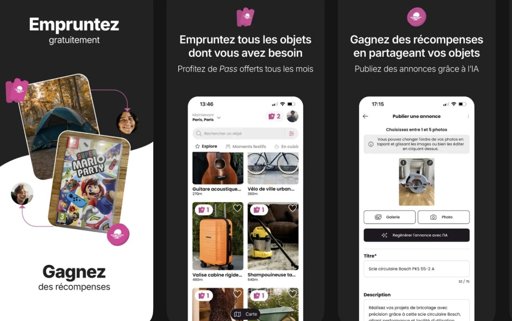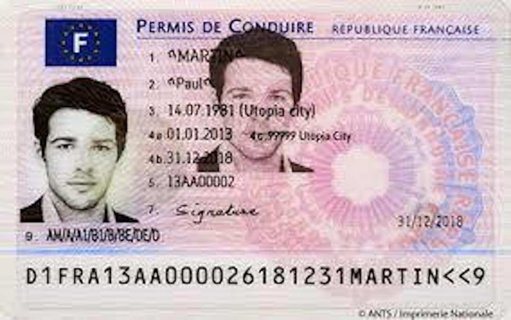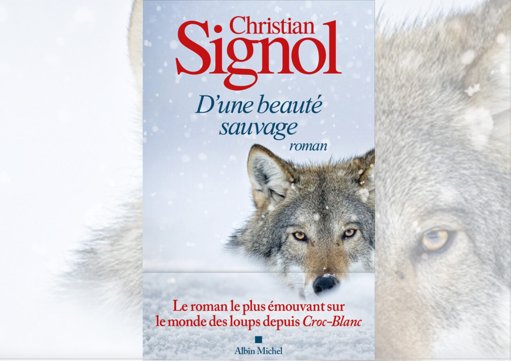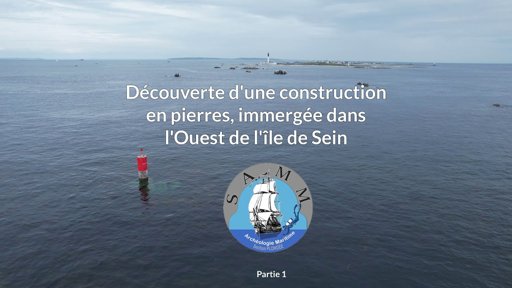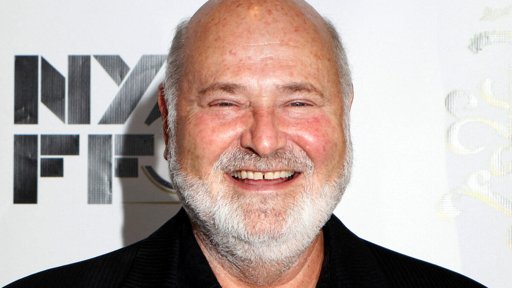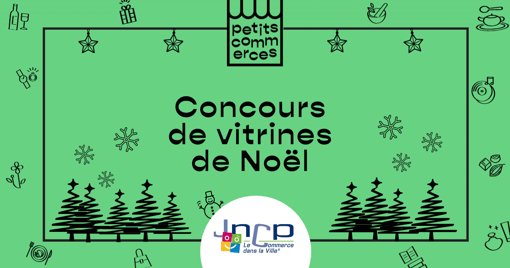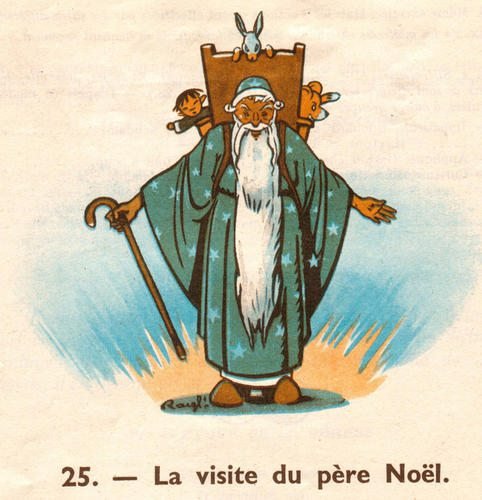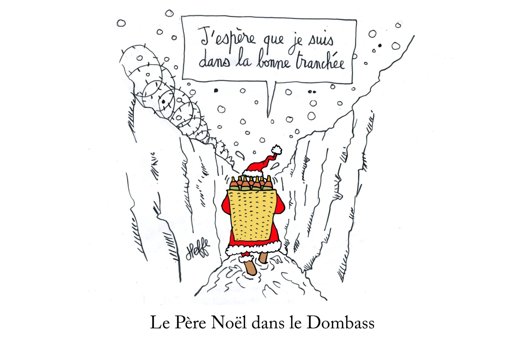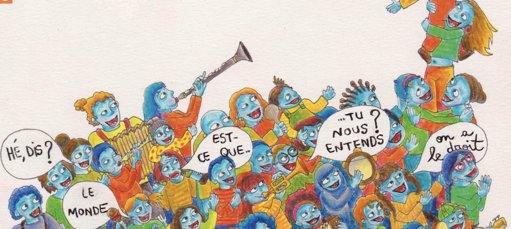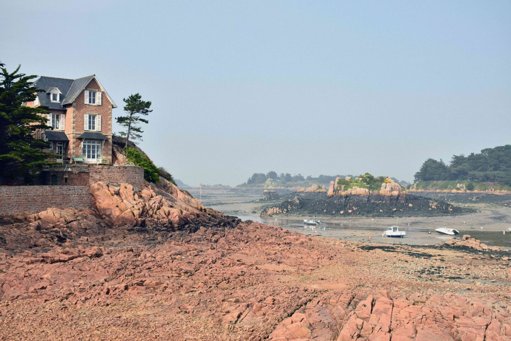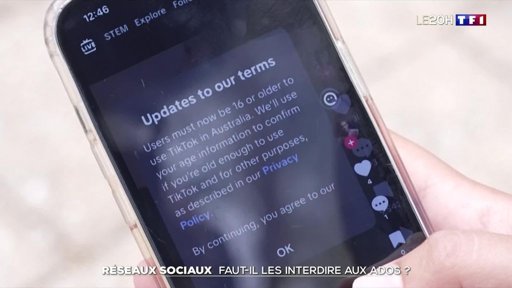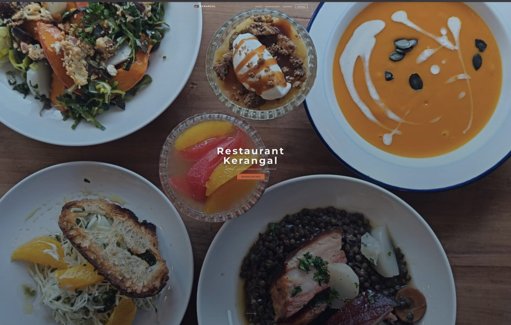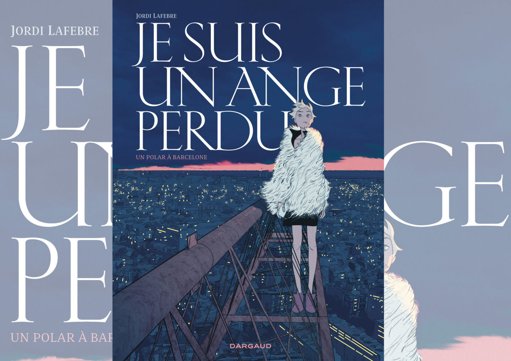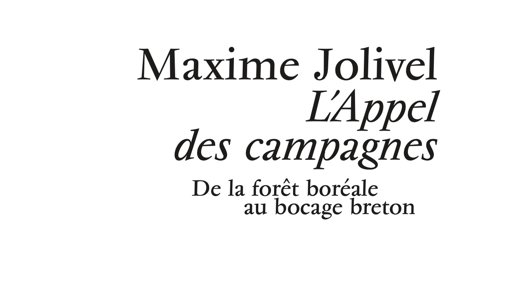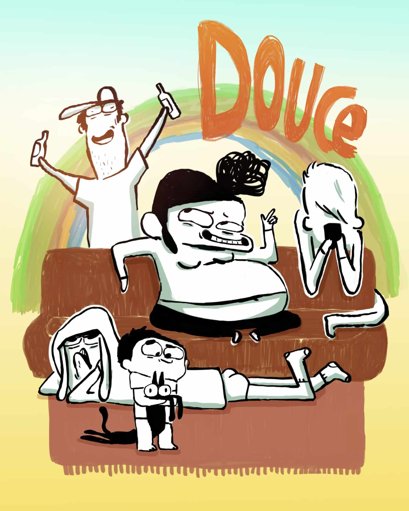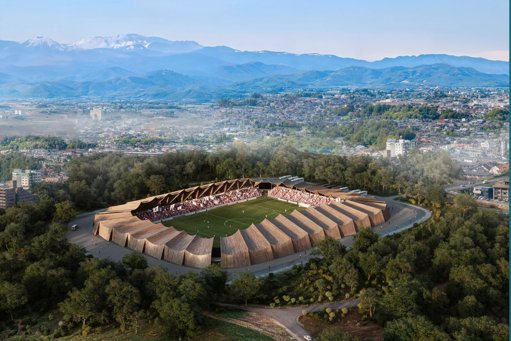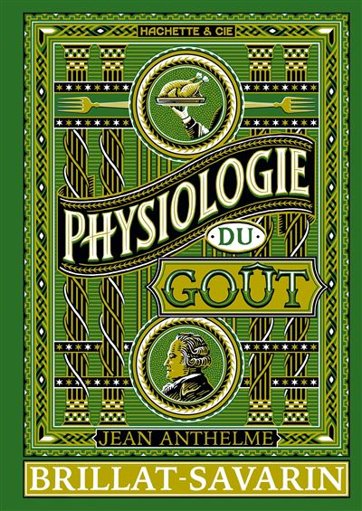Où se tatouer à Rennes ? Guide du tatouage de la capitale bretonne
La France compte aujourd’hui entre 4 000 et 5 000 studios de tatouages contre une vingtaine dans les années 1980. Qu’il soit symbolique ou esthétique, petit ou grand, le tatouage s’est peu à peu démocratisé dans la société. Notre capitale bretonne regorge d’artistes à l’aiguille talentueuse qui méritent un coup de projecteur ! Guide pratique des salons et studios de tatouage de Rennes. Le tatouage est par définition « un dessin décoratif et/ou symbolique permanent effectué sur la peau ». Attesté en Eurasie dès le Néolithique (entre - 6 000 et - 3 000, avec une chronologie variable selon les régions), il était une manière de marquer son appartenance à un clan - qu’il soit tribal ou religieux, qu’il s’agisse des pirates ou des légionnaires, etc. - et plus tard, à un groupe social (marins, gangsters, prisonniers, etc.) Selon David Le Breton, professeur à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France et chercheur au laboratoire Cultures et Sociétés en Europe, le tatouage était symbole de mauvaise conduite. Il était attribué aux marginaux ou personnes peu fréquentables. Il est depuis intégré dans la société, cependant, plus un goût personnel qu'un symbole d'appartenance, il n’en demeure pas moins mal perçu par certaines classes sociales. La Bretagne by Fanny dx, tatoueuse chez Buzztattoo © Buzztattoo, Rennes Les grands types de tatouage Il existe bon nombre de styles de tatouages — réaliste, horror, ornemental, celtique, etc. Ajoutons à cela l’univers propre à chaque tatoueur. Quelques pistes des tatouages les plus répandus : Polynésien et maori : Ce tatouage évoque un art ancestral et constitue un hommage rendu aux peuples primitifs. Il est composé de motifs abstraits complexes. Le tatouage tribal s’inspire des tatouages polynésiens et maoris. « Old school » : Ancres marines, aigles, visages de femmes… Ces tatouages dits traditionnels renvoient à une esthétique figurative et à l’univers des marins, du rock ou des motards. « New school » : Ce style est né dans les années 1990 et reprend les motifs « old school » en les modernisant. Couleurs très vives et contours exagérés, il rappelle la culture graffiti et l’esthétique cartoon. Tatouage asiatique réalisé par Sylvain C Bien (@syl20cbien,), 2022 © Calavera Tattoo, RennesTatouage « Old school »Tatouage ornemental réalisé par Laloo © Bayoo Tattoo, Rennes© Bernard Brault 2008/01/29 Jean-Yves, un tatoueur et son visage tatoué à Taiohae sur l'île de Nuku Hiva aux îles Marquises dans le Pacifique Sud. Tatouage ornemental : Très en vogue actuellement, le tatouage ornemental est un véritable bijou pour le corps. La finesse du trait se met au service de multitude de motifs possibles (la rosace, le mandala, la dentelle...) dans un souci du détail très pointu. Traditionnel asiatique : Le tatouage asiatique s’inspire de l’art chinois ou japonais, notamment des estampes. À l’origine associé aux sociétés secrètes d’Asie du Sud-Est, ce style est aujourd’hui utilisé par les Yakuzas et a une signification forte. On y retrouve des dragons, des tigres, des poissons ou encore des fleurs de lotus. Tatouage graphique : Style récent qui s’est développé avec la nouvelle vague de jeunes artistes tatoueurs. Il est fortement influencé par une esthétique moderne et joue avec les formes et les couleurs. La Belle Ville (Instagam) Depuis le 5 avril 2025, ce nouveau lieu propose une nouvelle offre en matière de tatouages. L'espace multiplie les activités : barber shop, tatouage et Nail Art. 65 mail François Mitterrand, 35000 Rennes https://unidivers.fr/rennes-belle-vie-salon-beaute-multi-services/ Bisou Tattoo (Instagram) @crashtest.tattoo Le tatoueur Gab_ink35, Gabriel Frenandez de son vrai nom, a réuni autour de lui une famille de 13 artistes, dont une perceuse (et apprentie tatoueuse) et une prothésiste ongulaire/strass. Apprenti.e tatoueur.se, jeune tatoueur.se ou artiste tatoueur.se, le niveau est différent, mais la passion la même. 4 Rue du Lieutenant Colonel Dubois, 35000 Rennes Magma Tattoo Club (Instagram) © Romanimale © Nins_nekketsu © Dounia_pocalypse Le studio de Magma Tattoo Club détonne sur la scène rennaise du tattoo par son univers joyeusement coloré dès la porte d'entrée. Implanté 165 rue de Saint-Malo, il est né des esprits follement créatifs des tatoueuses Romanimale et Nins_nekketsu. La première développe un univers fin qui puise son inspiration dans la statuaire et le floral notamment, tout en se laissant parfois aller à des lettrages dans lesquels émotion et revendication ont parfois les rôles principaux. Ses tatouages aux ombrages délicats faits en points se posent naturellement sur le corps. La seconde déploie un univers artistique hétéroclite dont le maître mot est la justesse du dessin. Le trait précis et sombre de Nin's se décline, entre autres, en formes abstraites, motifs animaliers ou lettrages, selon ses envies pour les flashs et les commandes des personnes qui la contactent. Elles sont accompagnées dans cette aventure d'une autre artiste qui s'épanouit dans cet art corporel. La tatoueuse Dounia_pocalypse est la spécialiste au shop du handpoke, un tatouage à l'aiguille et pas à la machine. Elle propose de petits décors de peau encrés qui vont parfois chercher du côté des dessins ornementaux, du paysage ou de la pop culture. Magma Tattoo club, 165 rue de Saint-Malo. Rose Corbeau (Instagram) © Criquet ttt© Sourire pluvieux © lesfleurstristes © Tommy © teawithsatan Le studio privé Rose Corbeau est constitué de 5 adeptes de l'encre : Sourire pluvieux, Tommy, Teawithsatan, lesfleurstristes et Criquet. Criquet tatoue « vers le pointillisme et l'Au-delà », comme il le souligne lui-même sur les réseaux. En résulte un univers singulier fait de points, d'abstraction et de figuration, dans lequel les motifs antiques (vases, statuaire) ont une place importance et dont les lignes pointilleuses gothiques semblent une signature. Le blase de Sourire pluvieux est à l'image de son travail artistique : son trait noir épais se développe dans des thématiques obscurs comme la mort, avec cependant une éclaircie de petits tatouages où fleurissent des motifs végétaux dans le cadre de commandes notamment. Avec lesfleurstristes, textes et images sont au service d'un univers particulièrement punket urbain. Tommi s'épanouit également dans un style blackwork sombre qui semble puiser ses inspirations dans des motifs animaliers comme le rottweiler et les profondeurs que l'on aime sur notre peau mais que l'on aimerait peut-être pas côtoyer dans la vraie vie : poings américains, figure de la mort, objets liturgiques détournés, même la gentille console gameboy se retrouve enclavé de fil barbé. Teawithsatan définit son travail comme des tatouages mystiques à la ligne fine. Ne vous fiez pas à son blase, le travail de la tatoueuse est d'une douceur. Son trait dessine des bijoux de peau avec une grande finesse et délicatesse, donnant une impression de crayonné et un onirisme particulier. Ses thématiques sont variées, mais le végétal, l'animalier et des objets ornementaux qui rappellent le style rococo (bougeoirs et des miroirs), reviennent souvent. 8 rue du docteur Francis Joly, Rennes * Studio Canopée Tattoo (Instagram) Lemä aka @lematattoo_ Colette aka coucoucolette.ttt Mathilde aka @holy_thelma © Cezart Tattoo © Vagabonde Tattoo © Toby Tattoo Situé 45 rue de Dinan, le studio de tatouage privé Canopée, fondé par Vagabonde tattoo, est la réunion de quatre artistes résident.e.s. La ligne de la fondatrice puise son inspiration dans les motifs végétaux et animaliers, mais valorise également des visages et courbes féminines. Les ombrages délicats donnent du relief à un tatouage qui se rapproche du bijou de peau tant il est travaillé dans la subtilité. Chez Toby tattoo, adepte de la grosse aiguille, on peut sentir une attirance pour "new school" : on y retrouve la touche cartoonesque et les codes du "old school" dans sa façon de travailler une ligne épaisse et d'utiliser parfois la couleur, tout en revisitant les thèmes dessinés. Ses références sont diverses, la culture pop côtoie notamment la culture urbaine et les motifs végétaux. Le tatoueur Cezart tattoo, Jordan de son vrai nom, a développé un style empreint de références gothiques et à la ligne marquée. Les fleurs peuvent adopter une esthétique piquante, le motif des ailes habille diverses compositions et des arabesques côtoient un dessin figuratif comme un visage. On sent dans le style de coucoucolette.ttt une inspiration old school bien que les thématiques peuvent diverger de celles connues dans le tatouage trad. Pour finir, lematattoo_ propose des dessins dans l'air du temps et des thématiques éclectiques - compositions florales ou ornementales, motif animalier, etc - avec semble-t-il un intérêt particulier pour le travail de l'ombre. La studio accueille également de guests régulières comme holy_thelma dont l'aiguille s'est épanouie dans un style doux et épuré aux lignes fines, très japonisantes, dans lesquels la figurine féminine, notamment, tient une place importante. Canopée tattoo studio, 45 rue de Dinan. Sur rdv par mp sur Instagram (Flashs et projets) * La Porte rouge (Instagram) © Lady Pink © Lady Pink Dans son studio de tatouage La Porte rouge, 10 boulevard Laennec, Lady Pik, tatoueuse aux multiples talents puisqu’elle évolue dans le traditionnel et le dotwork, la black work et le color, mais propose aussi un style ornemental. * L'Appart (Instagram) © Boule prince© tattoo cy© L'Aiguille écarlate© Ugo Eon À l'initiative du studio La Maison à la Mézière (cf. paragraphe plus bas), le tatoueur Jim est également propriétaire de L'Appart, boulevard de la Liberté. Cinq tatoueurs et tatoueuses évoluent dans cet univers au cœur de Rennes. Les motifs floraux et animaliers de Boule prince habillent finement les peaux et Cyril s'inspire fidèlement de l'animation japonaise et de la pop culture avec une grande précision. Dans un traitement totalement différent, la pop culture compte également parmi les références de L'Aiguille écarlate, jeune tatoueuse dont le travail promet un bel avenir. Il en va de même pour Ugo Eon, dont le trait s'inscrit dans un style actuel au répertoire varié, parfois abstrait * L'Atelier Noir (Instagram) © DR - Atelier Noir Uniquement sur rendez-vous, le studio privé Atelier Noir est spécialisé dans l'encre noire et la ligne fine, le travail au point (dotwork) et la lettrine. Atelier Noir. 43, rue de Paris, 35 000 Rennes. 06 27 39 28 80 * Le Studio privé d'Elodie.tattoo (Instagram) © Elodie Tattoo © Elodie Tattoo Comme tout.e autodidacte qui se respecte, Élodie a réalisé son premier tatouage sur elle dans son appartement lyonnais en janvier 2019. L’inscription « Viens on s’en fout » a lancé sa carrière dans le tatouage. Elle a ensuite commencé à tatouer ses ami·e·s au handpoke, passant tout naturellement au point. « J'ai toujours travaillé dans l'univers artistique, devenir tatoueuse était l'une des suites logiques », déclare la tatoueuse. Après un an à la Maison Tattoo et Art Shop (voir description plus bas), Élodie a ouvert son studio privé en septembre 2020, dans le quartier Sacré-Cœur de Rennes. Elle pique seule et invite parfois des amis et amies (tattoo/piercing) avec qui elle fait des échanges de guest afin de garder une ambiance collégiale. « Les gens parlent de mon style comme "pointilleux" et poétique. Mon univers c'est la mer, la lune, l'art et le voyage. Tout ce qui me passionne. » Les œuvres de Magritte, Edvard Munch ou encore Frida Kahlo, des paysages s'impriment sur les parties du corps en de fins pointillés que de fines lignes droites viennent parfois compléter. Pour tout renseignement, contacter l'artiste par le biais de son compte Instagram. * Studio Carbone Quatorze (Facebook / Instagram / Site) © Bellesetbuth, Studio Carbone Quatorze, Rennes© Aulp Mecca© Antoine le Chevalier © La Guish Le studio de tatouage Carbone Quatorze a ouvert ses portes début septembre 2020 au 168 rue d’Antrain. Aux commandes : Alexandre aka Bellesetbuth. Exilé parisien pendant des années, l’artiste rentre à la maison et pose ses valises dans notre belle ville avec des idées plein la tête. Au street shop ouvert au public, l’artiste a préféré le côté cosy d’un studio privé. « L’objectif est de faire venir des artistes aux techniques et styles différents de celles utilisés par les tatoueurs rennais. » Bellesetbuth tatoue comme il dessine et au Studio Carbone Quartoze, on parle de dessin avant de parler de tatouage. L’aiguille et l’encre arrivent après. Sa spécialité ? La faune et la flore ! Dans un trait fin, précis et détaillé, des arachnides, des invertébrés ou encore des félins, parfois pimentés d’un crâne ou deux, courent sur les corps de ses clients. Le style figuratif fait d’aplats noirs prend des allures de gravures anciennes avec une touche contemporaine, personnelle. L'artiste s’est forgé un style rétro-futuriste au fil du temps et des rencontres. Au cœur de cette jungle encrée, le serpent a une place privilégiée. Le reptile s’enroule, se faufile et se pose sur une partie du corps. « C’est un peu mon animal totem. Ils sont identiques, mais différents. Cet animal possède une symbolique forte et de multiples significations : résurrection, savoir-faire, clairvoyance, etc. » À ses côtés, l'aiguille d'Antoine le chevalier s'épanouit dans un style gothique aux traits épais et marqués, l'univers encré de La Guish est principalement habité de paysages faits aux contours (elle propose d'ailleurs des flashs et accepte les projets) et les tatouages de Freya Clarke sont une extension de son travail de peinture, la couleur en moins. Ses formes simples et douces, souvent arrondies, vont puiser parfois dans l'univers forain, parfois dans le végétal et l'animalier. Carbone Quatorze. 2 rue de la chalotais, 35 000 Rennes. Seulement sur rendez-vous. Pour lire notre article écrit à l'ouverture du studio : https://unidivers.fr/tatoueur-bellesetbuth-rennes/ * Studio Privé Mélanie Robak (Facebook/Instagram) Implanté au cœur de l'association d'artistes Les Agités, Mélanie Robak, de son vrai nom Mélanie Hummel, a ouvert son studio en janvier 2020. Autodidacte, elle pratique le tatouage depuis trois ans et s'est spécialisée dans la technique handpoke. « Le handpoke est une technique inspirée des origines du tatouage. On travaille à l'aiguille, mais sans machine. J'utilise des aiguilles à tatouer directement à la main point par point. C'est une manière de reprendre ce qui a plus ou moins disparu avec l'arrivée des machines, mais qui revient peu à peu sur le devant de la scène grâce à de nombreux artistes talentueux ». S'étant perfectionnée au fil de ses rencontres avec des tatoueurs, Mélanie Robak tend vers un style minimaliste, principalement abstrait ou botanique. « Je dessine principalement des modèles au Dotwork (au point), utiliser le handpoke était alors une évidence pour que le rendu sur la peau corresponde aux dessins que je propose ». * La Maison - Tattoos & Art Space (Facebook / Instagram) Tatouage réalisé par BadMokey © La Maison TattooJim, La Maison Tattoo et Art Shop, RennesTatouage réalisé par Gaby © La Maison TattooTatouage réalisé par JD © La Maison TattooTatouage réalisé par La Malice © La Maison TattooTatouage réalisé par LéAmour © La Maison Tattoo Confortablement installés dans une maison à la Mézière, huit artistes aux univers et styles variés évoluent dans ce studio de tatouage. Infographiste de formation, Jim propose naturellement des flashs graphiques et géométriques et BadMonkey et ses lignes fines, tout en noir et blanc ou gris et blanc, sauront répondre à tous vos projets de tatouage. Et l'univers de LéAmour se développe autour de trois inspirations principales : la déclinaison du mot amour, le tatouage ornemental et les papillons. Le réalisme du trait, principalement des petits formats, de JD décorera votre corps avec discrétion. De même pour les typographies et les dessins tout en finesse de La Malice. Et la précision du micro-réalisme de Salegosse, Maxime Gesnouin de son vrai nom, habillera magnifiquement votre corps. Emtontattoo propose également un style réaliste fait de noir avec des touches couleurs qui donnent du relief. La figure de la femme et le motif animalier sont particulièrement présents dans ses dessins. L'équipe se termine avec Michette, baby tatoueuse, qui propose des tatouages actuels aux lignes nettes et thèmes légers. Ses inspirations entre autres : le floral et le féminin. La prise de rendez-vous se fait sur leur page Instagram. 1 rue de la Courois, 35 520 La Mézière. 06 73 12 27 24 / lamaisonrdv@gmail.com * Atomik Tattoo (Facebook / Instagram) https://youtu.be/mui4icBFpDQ Véritable figure emblématique de la scène tatouage en France, Miss Atomik est aux commandes du salon Atomik Tattoo depuis son ouverture en 2007. Connue pour la qualité de son travail, elle évolue et excelle dans l’univers old school et néo-traditionnel. À ses côtés, Eddie est spécialisé dans le dotwork (littéralement, « travail en points ») et le graphique. 192 Rue de Nantes, 35 000 Rennes. 09 51 59 29 43 * Bayoo Tattoo (Facebook / Instagram) Tatouage réalisé par Jefferson © Bayoo Tattoo, RennesTatouage réalisé par Laloo © Bayoo Tattoo, Rennes© Dabanadadou, Bayoo Tattoo, Rennes Jefferson, Laloo et Dabanadadou forment un trio de tatoueurs et tatoueuse complémentaires dans le centre-ville historique de Rennes, à côté des Portes Mordelaises. Chez Bayoo Tattoo, salon né d'une campagne de crowdfunding, la délicatesse du trait de Laloo, tantôt fin, tantôt épais, et l’utilisation du dotwork (travail au point) dans la création de ses mandalas donnent un style à la fois graphique et ornemental. L'univers new school et bande-dessinée de Jefferson laisse quant à lui parler autant les encres colorées que la noire. Et au vu de ses tableaux exposés dans le salon et des photographies, sa machine est plus que qualifiée pour des tatouages réalistes. Le binôme a été rejoint plus tard par Dabanadadou, connu aussi sous son blase de graffeur Lélé. Son univers artistique développé sur les murs de l'espace public se prolonge dans le tatouage. Chaque tatouage est une pièce unique qui ne sera jamais reproduite à l’identique. Pour une transparence totale, Jeff et Laloo s’interdisent la réalisation de tatouages maori ou polynésien par exemple. « Chaque symbole a une signification et à Rennes, des tatoueurs en font leur spécialité. On préfère les rediriger vers eux », souligne Laloo lors de sa rencontre avec Unidivers. 2 rue des portes Mordelaises, 35 000 Rennes. 09 86 27 24 52 * Sémilla (Site / Facebook / Instagram) Madame L Jacqueline Tattoo La Valse à mille pointsChardon Doré Anciennement aux commandes du salon d'esthétique Le Boudoir, la tatoueuse Madame L, esthéticienne de premier métier, a depuis 2019 renommé sa boutique pour en faire un véritable salon de tatouage du nom de Semilla. Elles sont désormais quatre tatoueuses à évoluer dans les lieux. Semilla est avant tout un salon de tatouage dans lequel est proposé une partie boutique avec des cosmétiques, des bijoux, de la papeterie et des produits de soin post tattoo. La quasi totalité est made in France ou local. À la carte et sur devis uniquement (flash également disponible), Madame L développe un style minimaliste et extrêmement fin, un univers fleuri et apporte par la même une nouvelle image au tatouage, une image dans l’air du temps. Jacqueline s'épanouit quant à elle dans un univers floral et néo-trad, qui ancre la peau autant en couleurs qu'en noir et blanc. La jeune tatoueuse lavalseamillepoints s'est spécialisé dans le dotwork et le handpoke. La lune, le floral, des paysages et l'abstrait habilleront les peaux des personnes qui seront intéressées par son travail. Quant à Chardon Doré Tattoo, le trait réaliste de ses tatouages est plus foncé, avec toujours une présence du floral, mais pas seulement. Nouvelle recrue, la tatoueuse mexicaine DanBravo allie visages fracturés ou entiers, géométrie et motifs floraux dans des créations d'une extrême douceur, aux lignes fines et aux ombrages délicats. Elle propose des flashs, mais accepte aussi les projets. 144, Rue d’Antrain, 35 000 Rennes. 02 23 46 75 52 * Buzztattoo Rennes (Facebook / Instagram) Tatouage d'Isidor.ink © Buzztattoo Tatouage d'Alice Patulacci Deux artistes taoueur.se.s évoluent dans le salon Buzztatoo, chacun avec un style affirmé pour un répertoire large. Par mois, de nombreux guests sont accueillis et apportent ponctuellement un vent de nouveautés graphiques au salon. Les pièces colorées et les courbes d’Alice Patulacci, tatoueuse depuis 2014, traduisent un univers moderne, à la rencontre entre le néo-trad' et le cartoon. Elle ne refuse cependant pas de sortir des sentiers battus et de plonger dans le noir et blanc ou dans la réalisation de tatouages plus réalistes et géométriques selon le désir des clients. Lionel, ou Isidor_ink, est arrivé dans les lieux en 2019. Son style, presque exclusivement noir et blanc, se construit autour de visuels réalistes à la technique impressionnante. Le travail d'ombres et de lumières se met au service de motifs très diversifiés avec néanmoins une préférence. « Je fais du blackwork, surtout du dotwork. Les sujets que j'aime traiter sont assez variés mais mes thèmes de prédilection sont le religieux et l'animalier ». Tous deux ont été rejoints par la suite par Rocket Vanille et son univers habité principalement par des créatures félines et autres chimères, et Himelilt qui s'inspire de la pop culture pour des tatouages au style néo-trad' et aux couleurs aquarelles. 129 rue de Fougères, 35 000 Rennes. 09 81 35 61 96 * Calavera Tatouage (Facebook / Instagram / Site) Tatouage réalisé par Sylvain © Calavera Tattoo, Rennes En 2018, la photographie d’une Japonaise au dos magnifiquement tatoué est utilisée pour l’affiche du festival Jazz à l’Ouest… ce n’est qu’une des nombreuses merveilles encrées de Sylvain, propriétaire de Calavera Tattoo qui a déménagé depuis le 1er août 2024 dans un studio privé shop privé à Ercé-près-Liffré, en Ille-et-Vilaine. Pour une envie de tatouage aux inspirations japonaises, aucun doute que ce soit l’endroit que vous cherchez. Les huit artistes-tatoueurs évoluent dans des univers divers, mais complémentaires afin de proposer un travail de qualité. Le studio est aujourd’hui considéré comme un des meilleurs à Rennes (si ce n’est le meilleur). Comme beaucoup de salons à Rennes, Calavera Tatouage invite tous les mois plusieurs guests. Retrouvez les sur le site Internet et n'hésitez pas à suivre l'actualité de son shop sur son compte Instagram. 35340 Ercé-près-Liffré. À contacter par mp sur Instagram * Spirit Tattoo (Facebook) © Did-K© Nadoz© Tiwan© Marlouchka© Mathias Jean© Le Kid Spirit Tattoo a ouvert ses portes en 2007. Lieu de référence pour le tatouage made in Rennes, six tatoueurs évoluent dans la boutique, chacun avec une spécialité différente : l’irezumi pour Didier ou Didkvray (une forme particulière de tatouage au Japon qui recouvre de larges parties du corps) ; le new school kawaii chez Malourchka ; le style géométrique ornemental de Nadoz et l’univers old school et traditionnel de Tiwan. À leurs côtés, Le Kid évolue dans un univers de pop culture - cinéma, manga et jeux vidéo - et Mathias Jean propose des créations aussi bien au handpoke qu'à la machine, des ornements pour la première technique et des tatouages trad pour la seconde. Afin de créer un turn over intéressant, le salon accueille tous les mois des guests, français ou internationaux. 26 Rue Paul Bert, 35000 Rennes. 02 99 67 27 18 * Inkerman Tattoo Shop (Facebook / Instagram) © Ju Massé © Happy Hands En 2014, un nouveau salon de tatouage voit le jour à Rennes : Inkerman Tattoo Shop. Aux commandes, Bastien Demengeot alias Bastoche. Véritable machine multifonction, il accueille et conseille chaque personne qui franchit la porte d’entrée. À ses côtés, Julien, spécialiste du blackwork. L’artiste sait tout faire — géométrie, ornemental ou old-school — du moment que c’est noir ! Delphine, spécialiste du néo-trad’ et du blackwork, vient également leur prêter main-forte. A ses côtés, Ju Massé, adepte du Blackwork, et Happy Hands et son univers follement coloré. 61 bis Rue Saint-Hélier, 35 000 Rennes. 02 57 21 17 63 * Kalil Tattoo Family (Facebook / Instagram / Site) Tatouage réalisé par Calvin © Kalil Tattoo Family Installé depuis plus de dix ans à Rennes, Kalil Tattoo Family a déménagé en septembre 2018 et pris ses marques dans le concept store Avec & Co. Comme le stipule le nom, le salon de tatouage est une histoire de famille. Baignés dans cet univers depuis leur plus jeune âge, Calvin et Kalil Junior, qui a ouvert une antenne à la Réunion, ont suivi les traces de leur père Kalil. Organisateur de la Corsair Tattoo Ink, salon du tatouage de Saint-Malo, sa réputation n’est plus à faire. Du réalisme au néo-traditionnel, en passant par le japonais, dotwork (pointillisme), minimalisme et floral, cinq tatoueurs et une perceuse travaillent dans le shop afin de conseiller au mieux la clientèle sur la base d’un répertoire large de propositions. 1 Rue du Breil, 35 000 Rennes. 02 99 41 97 32 * Minh Thu Piercing & Tatouage (Facebook) Entrer chez Minh Thu c’est comme pénétrer dans un cabinet de curiosités géant. Une collection impressionnante de crânes de tous types et de toutes tailles accueille la clientèle. Depuis peu, la perceuse a agrandi son local non pas d’un, mais de deux tatoueurs. 11 Passage des Carmélites, 35000 Rennes. 02 99 78 27 65 * Rondy Tattoo Studio (Site / Facebook / Instagram) Passionné de dessin depuis sa plus tendre enfance, la machine s’est mise en marche à l’âge de 13 ans pour Rondy Jean-Marain. Il exerce depuis 10 ans et est spécialisé dans la création de portraits, mais conserve un répertoire large. Il n’est ainsi pas rare d’apercevoir entre deux dessins réalistes, un tatouage old school ou au style graphique. Seulement sur rendez-vous. 119 Rue de Vern, 35 200 Rennes. 06 72 63 66 04 - rondytattoo@gmail.com * Le Studio Tattoo et piercing (Facebook) © Gone tattoo 35, Le Studio, Rennes @ Gone tattoo 35, Le Studio, Rennes© Im Fox Tattoo, Le Studio, Rennes Les lettres gothiques et les couleurs de la devanture rue d'Antrain annoncent une ambiance 100 % rock et punk. Salon reconnu sur la scène tatouage et piercing à Rennes, l’ambiance, l’hygiène et la rigueur au travail sont autant de qualités qui incitent la clientèle à revenir au Studio. Les petits tatouages à l'aiguille fine de I'm fox tattoo côtoient l'univers plus gothique, au répertoire très large, de Gone tattoo 35. 18 rue d’Antrain. 35 000 Rennes. 02 99 63 35 73. * Tattoo Mania (Facebook / Site) En quinze ans d’expérience, Yann a développé des styles multiples qui permettent de répondre à une large demande. Du petit au grand format, le tatoueur met un point d’honneur à discuter avec le client avant d’allumer sa machine. Sachant qu’il s’agit d’une transformation du corps, prendre le temps de travailler le dessin et le personnaliser selon le client semble essentiel pour lui. 5 Place Saint-Germain, 35 000 Rennes. 02 99 79 47 21 * Touche Perso (Facebook/ Instagram) Touche Perso, Rennes © DR - Touche Perso Tatouage réalisé par Yann de Touche Perso, Rennes © DR Installé à Rennes depuis 2005, Touche Perso est à la fois un salon de tatouage et de piercing qui reçoit exclusivement sur rendez-vous. Yob (@yann_toucheperso) encrera votre peau des commandes qui vous lui passerez ou de ses flashs singuliers à la forte empreinte new school, avec des motifs tantôt décalés comme un oignon et tomate, tantôt hippie, mais aussi, dernièrement, à la forte influence égyptienne. Sarah, aka @n0valbus, habillera votre corps d'encre mais aussi d'acier selon vos préférences, et @mignoncamarade s'occupera de percer le moindre recoin, ou presque, de votre peau ! 27 rue Maréchal Joffre, 35 000 Rennes. 02 99 78 59 91 * Tsunami Tattoo Rennes (Facebook / Instagram) Tatouage réalisé par Alexandre © Tsunami Tattoo, Rennes Après quelques temps rue d’Échange, Tsunami Tattoo a pris ses marques en plein centre-ville en 2017, rue Saint-Melaine. Cinq maîtres de l’aiguille sont aujourd’hui en résidence permanente et mettent leur art à votre service. Les photographies et dessins visibles en boutique révèlent le talent d’Alexandre pour le style polynésien et le style plus graphique et morbide de L’Écorcheuse, « un travail du trait qui fait la texture ». Adepte du polynésien, l’aiguille d’Eduardo signe également « du gros old school qui tache ». Apprentis à Tsunami Tattoo, femto_mori développe un univers dark original inspiré particulièrement par le cinéma d'horreur (Ça, Saw, Gremlins, etc.) et Le Crapaud travaille un style en noir et rouge, avec lettrages, symboles ésotériques et motifs possédés. 36 Rue Saint-Melaine, 35 000 Rennes. 02 99 79 71 69. * Nero Tattoo shop (Facebook / Instagram) Tatouage réalisé par Chris Nero © Nero tattoo shop Tatouage réalisé par Eddie puissant © Nero tattoo shop Tatouage réalisé par Monsieur Alfred © Nero tattoo shop Tatouage réalisé par Lina Tattoo © Nero tattoo shop Défini comme un cabinet de tatouage et de curiosités sur les réseaux sociaux, le Nero Tattoo Shop est un salon privé où évoluent quatre tatoueur.euses aux univers bien définis et personnels. Pépite du paysage rennais en matière d'encre corporelle, à la diversité des styles proposés s’ajoutent le talent et la passion de chaque artiste pour leur travail. Des dessins réalistes aux points inspirés de la pop culture d'Eddie Puissant aux courbes old school et néo trad d'Monsieur Alfred, en passant par l’esthétique des tatouages ornementaux de Chris Nero Tattoo, chacun a su s’approprier les codes de son style de prédilection et propose des motifs originaux. Le studio accueille également Lina Tattoo, tatoueuse apprentie qui se spécialise dans le tatouage asiatique. 12 Quai Duguay-Trouin, 7ème étage 35000 Rennes. 09 52 00 38 23 * Studio Les Filles du Calvaire (Instagram) © Le Ston, les Filles du calvaire, Rennes© Adastra, les Filles du calvaire, Rennes© Katsoutart, les Filles du calvaire, Rennes L'association Les Filles du Calvaire, c'est le regroupement de trois artistes-tatoueuses Katsoutart, Tirekusu (anciennement Le.Ston) et Adastra. Toutes trois formées en autodidacte, chacune propose un style dans l'air du temps. Différent, mais complémentaire, leur style est actuel et les lignes assurées, mais elles ne recherchent pas « le beau trait ou l'hyperréalisme », comme le souligne Katsoutart. Les traits sont parfois directs et épurés, d'autres fois plus croqués et hachurés. Chacune représente artistiquement sa réalité, ses centres d'intérêts et son engagement, parfois avec humour. « On dessine ce qui nous plaît personnellement », déclare Tirekusu qui va notamment chercher du côté de la pop culture, comme les mangas et les animés, et la culture japonaise. Mais parfois son aiguille se laisse aller à la représentation d'animaux, des dessins qui rappellent les planches naturalistes du XIXe siècle. La femme compte parmi les thèmes de prédilection de Katsouart, son trait est net et s'éloigne du dessin plus traditionnel. Adastra s'est quant à elle spécialisée dans le handpoke, le tatouage à la main et non à la machine. Ses motifs ornementaux se posent sur la peau comme des bijoux, toute en délicatesse. Deux artistes ont rejoint l'aventure : Étienne Dessin et ses dessins faits essentiellement de contours et de lignes (rarement des ombrages) aux références multiples, Katie Mcpayne et son style crayonné qui va chercher du côté floral et de la culture pop Seulement sur rendez-vous, les contacter via leur page Instagram. Pour lire notre article sur l'ouverture du studio : https://unidivers.fr/filles-du-calvaire-tatouage-rennes/ * Cœur d'encre (Facebook / Instagram / Site) Première séance d'une composition florale de Kenzo_tattoo © Coeur d'encre L'atelier de tatouage Cœur d'encre est l'antre de Kenzo et Momonoke. Implanté sur le mail Mitterrand, les deux artistes ont chacun et chacune un style bien défini. Le premier est connu pour la diversité de son répertoire artistique : motifs floraux, personnages, paysages ou encore animaux comptent parmi la palette de créations de ce dessinateur talentueux. La seconde puise ses inspirations dans la culture japonaise, particulièrement dans les mangas et animes, pour des tatouages aux lignes fines et précises. Actuellement, la famille Cœur d'Encre accueille deux artistes apprentis : Papyduck dont l'univers en noir et blanc se déploie dans le monde du old school et de la typographie et Morticia dont le blase résume parfaitement son style sombrement réaliste. Cœur d'encre. 85 Mail François Mitterand, 35 000 Rennes * Vous connaissez d’autres adresses à Rennes ? Dites-le nous ici afin de mettre à jour ce guide !