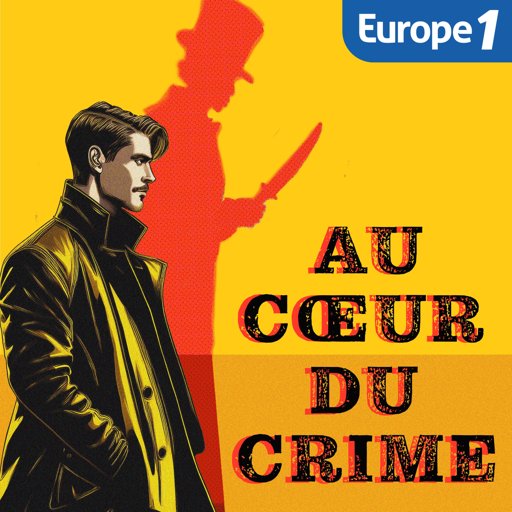Ce verdict, rendu sans corps ni aveux, clôt un procès-fleuve de quatre semaines qui a captivé l'opinion publique et soulève des questions sur la force de l'intime conviction des jurés. Le procès de Cédric Jubillar s'est conclu par une condamnation fondée sur un "faisceau d'indices graves, précis et concordants", en l'absence de preuves matérielles directes. L'accusation a soutenu que le meurtre a eu lieu lors d'une dispute la nuit de la disparition, alors que Delphine Jubillar s'apprêtait à le quitter pour refaire sa vie avec son amant. Les avocats généraux ont requis une peine de trente ans, soulignant que "le crime parfait n'est pas le crime sans cadavre mais celui pour lequel on n'est pas condamné".
La personnalité de l'accusé, décrite comme "cynique" et "désinvolte", ainsi que ses nombreuses contradictions tout au long de l'enquête et du procès, ont pesé lourd dans la balance. Son attitude impassible, même lors de témoignages poignants comme la lecture d'une lettre de son fils Louis l'accusant de violences, a marqué les esprits. Le témoignage de sa propre mère, qui a exprimé ses doutes sur son innocence, a également été un moment clé.
La défense, menée par Mes Emmanuelle Franck et Alexandre Martin, a plaidé l'acquittement, dénonçant un "désastre judiciaire" et une enquête menée uniquement à charge.
Ils ont souligné les failles du dossier, comme l'absence de scène de crime et de corps, et ont tenté d'instiller le doute, arguant qu'on ne pouvait condamner un homme sur de simples "convictions". Malgré leurs efforts, les jurés ont été convaincus de sa culpabilité. Les avocats de Cédric Jubillar ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel, promettant un "deuxième combat" judiciaire qui devrait se tenir en 2026.