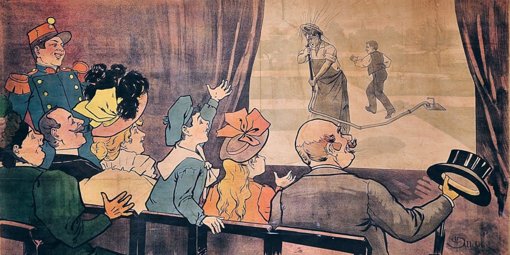« Bonjour ! » : La chanteuse Lorie, Jacques Legros et Cécile de Ménibus intègrent la matinale de TF 1
Elle ne cesse de s’étirer. À partir du 19 janvier prochain, « Bonjour ! », la matinale de TF 1, va gagner une heure d’antenne supplémentaire. Déjà allongée d’une demi-heure en début de saison pour être proposée de 6h55 à 10 heures, elle ira désormais jusqu’à 11 heures. La conséquence, notamment, de l’arrêt par la Une de son célèbre « Téléshopping ». « Nous avons voulu poursuivre le succès de l’implantation de cette matinale en direct », explique Thierry Thuillier, le directeur de l’information de TF 1.Déjà à la tête de trois heures d’antenne quotidiennes, Bruce Toussaint ne sera pas aux commandes de cette heure supplémentaire baptisée « Bonjour, avec vous ». C’est Christophe Beaugrand, son joker, qui en hérite. « Christophe est bien connu de nos téléspectateurs. Il est à la fois journaliste et animateur, une double casquette très intéressante pour nous », salue Thierry Thuillier.Se voulant « dans la continuité » du bloc principal, sa nouvelle partie se déroulera dans le même décor. Elle différera cependant d’un point de vue éditorial avec un format très magazine, sans JT, qui fera la part belle aux débats d’actualité autour de la vie quotidienne des Français.Une chronique sur la parentalité pour la chanteusePour l’accompagner dans ce talk-show, l’animateur de « Secret Story » pourra compter sur des visages connus des fidèles de « Bonjour ! ». Gardant leur emploi actuel, la professeure de fitness et spécialiste du bien-être Sandrine Arcizet sera ainsi de la partie, tout comme le médecin Vincent Valinducq.De nouveaux venus prendront aussi place autour de la table, et non des moindres. Fraîchement retraité du « 13 heures » cette année, Jacques Legros fera déjà son grand retour sur TF 1 en venant débattre quatre jours par semaine. Autre retour sur la Une, pour le moins inattendu : celui de Cécile de Ménibus, ex-figure de « La méthode Cauet ! » et actuelle voix de Sud Radio. Travaillant déjà pour « 50′ inside » sur la Une, la journaliste Julie Tomeï apportera son éclairage sur les questions culturelles, tandis que la journaliste de LCI, Bénédicte Le Chatelier, participera elle aussi aux débats chaque jour.La partie historique de « Bonjour ! » présentée par Bruce Toussaint va elle aussi accueillir un nouveau visage dès le 5 janvier, et non des moindres. Selon nos informations, la chanteuse de 43 ans, Lorie Pester, va ainsi rejoindre l’équipe pour incarner une chronique sur la parentalité et les questions familiales. L’artiste, mère d’une petite Nina, 5 ans, sera à l’antenne dans la partie magazine (9 heures-10 heures) chaque lundi.Des audiences au beau fixeCôté audiences, tous les voyants sont au vert pour « Bonjour ! ». Lancée en janvier 2024 sur un créneau ultra-concurrentiel, l’émission a réussi à s’installer comme la deuxième matinale de France derrière le leader « Télématin » (France 2), avec lequel elle réduit l’écart. Alors que Thierry Thuillier lui avait en juin dernier assigné comme mission d’atteindre les 12 % de part d’audience (PDA) d’ici la fin 2025, la quotidienne a dépassé cet objectif en affichant 12,7 % de PDA depuis septembre pour 385 000 téléspectateurs au rendez-vous chaque jour, en hausse d’un tiers par rapport à la même période l’année dernière.Pour le seul mois de décembre, « Bonjour ! » affiche même 13,5 % de PDA de moyenne. « On est au-delà de nos objectifs et évidemment ravi de ces résultats », commente Thierry Thuillier, se félicitant aussi de performances en progrès de plus de 30 % en un an sur les cibles publicitaires avec 12,5 % de part de marché sur les 25/49 ans. De quoi donner envie d’étirer encore plus la matinale dans un avenir proche ? « Ce n’est pas l’idée », assure le directeur de l’information de TF 1.